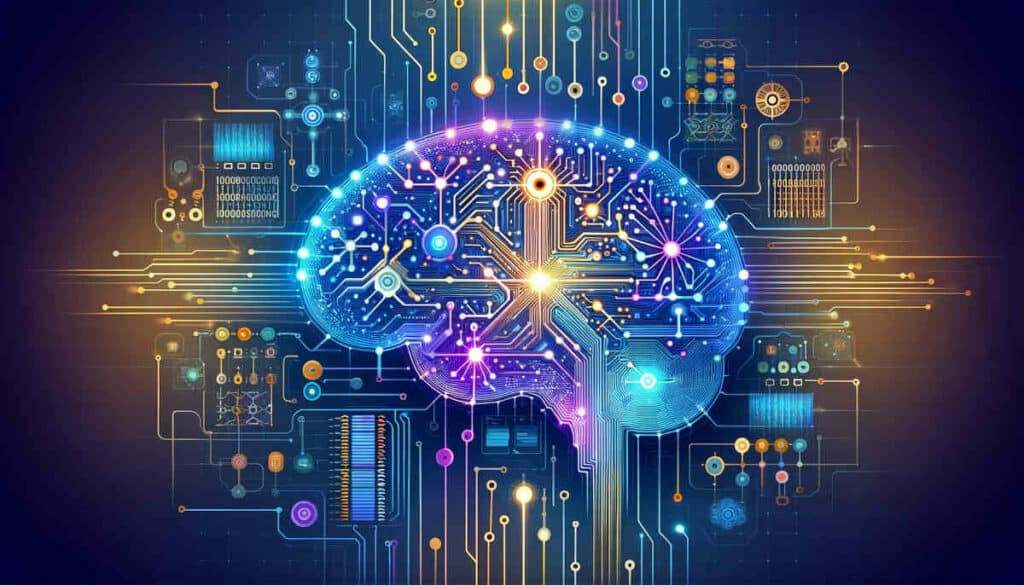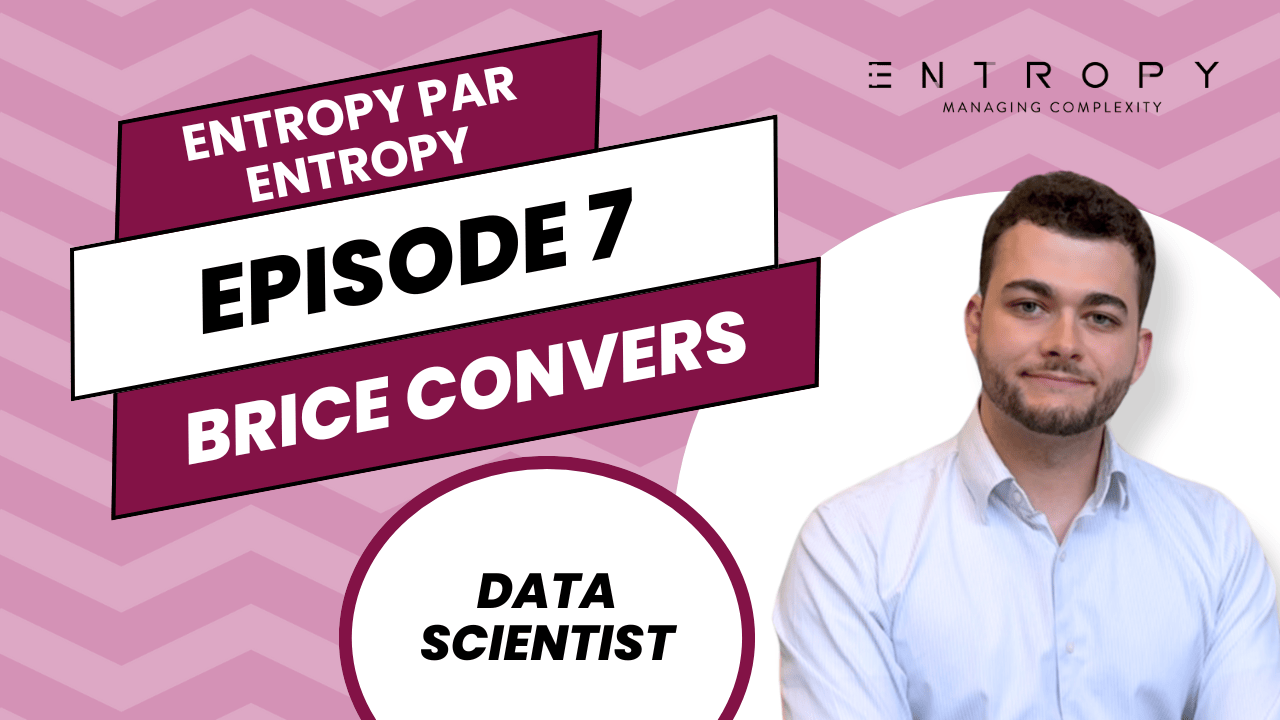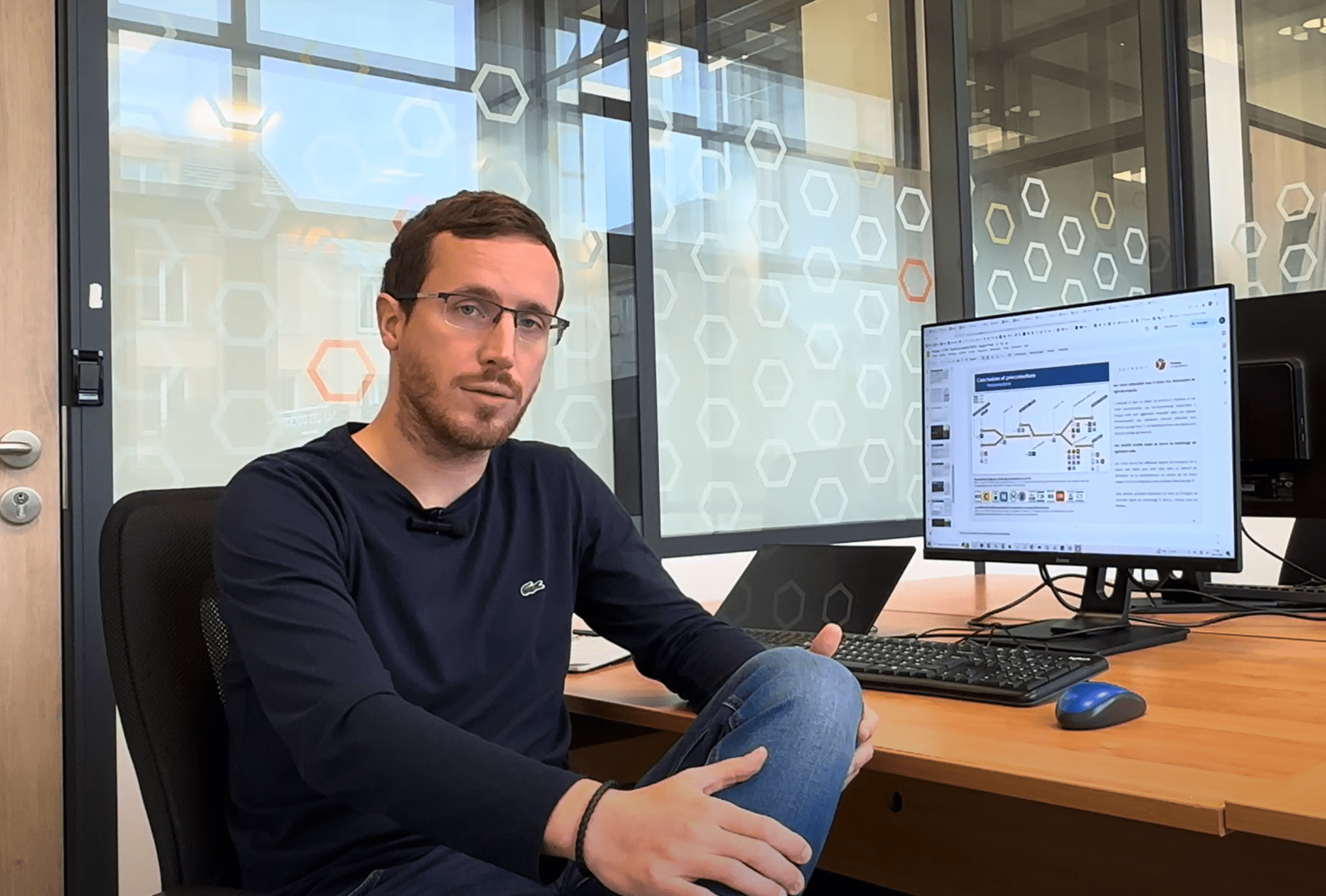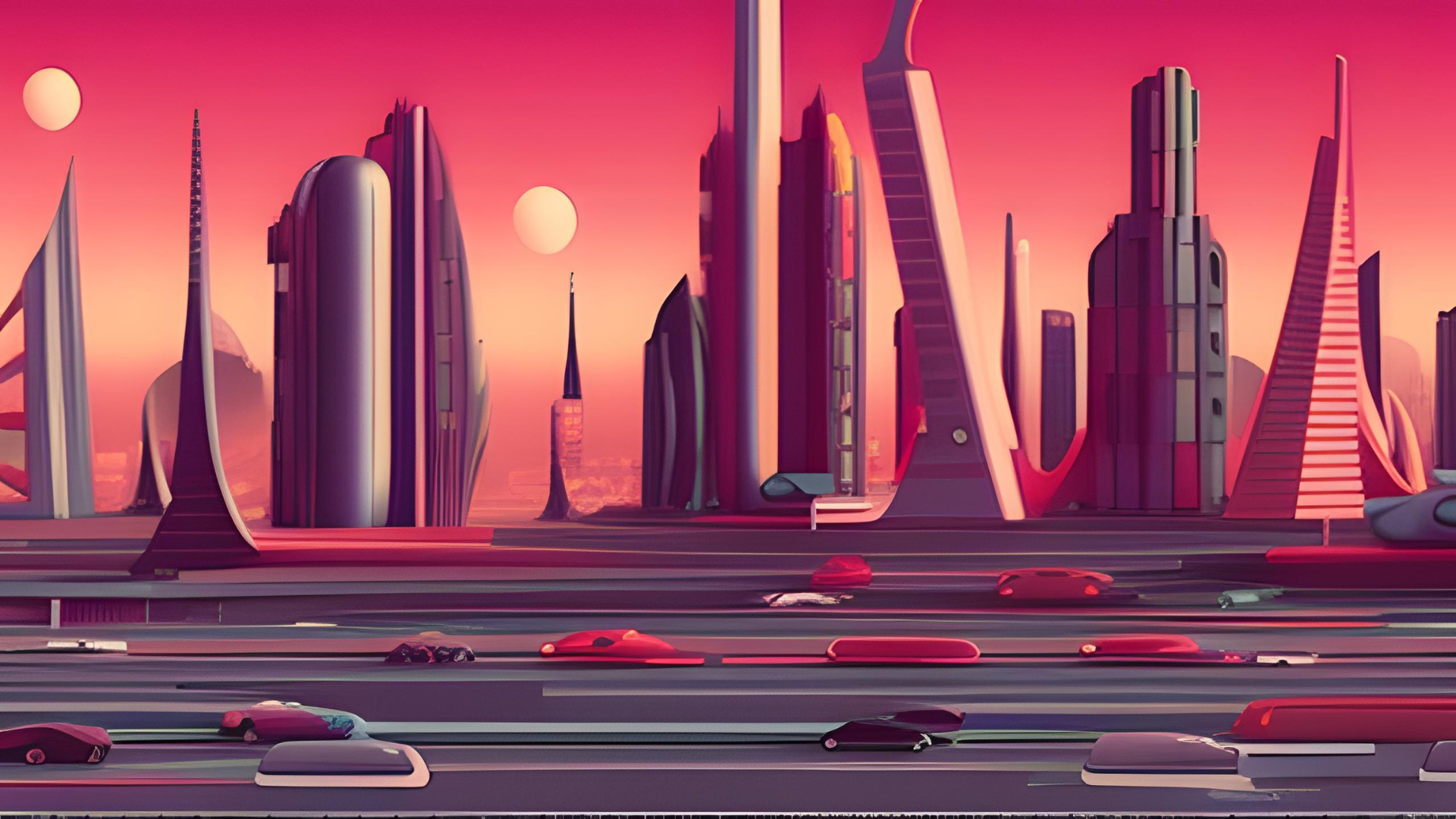© MasterLu - Unsplash / Pixabay
© MasterLu - Unsplash / Pixabay
7h52, station Châtelet. Un train bondé s’arrête. Les portes s’ouvrent à peine, quelques passagers réussissent à forcer leur entrée, d’autres attendront le suivant. Sur le quai, les visages sont fermés, le débit saccadé, les horaires déjà compromis. C’est un matin comme tant d’autres à Paris. Une ville dense, rapide, contrainte, où la mobilité quotidienne devient parfois un exercice de résistance.
À plus de 10 000 kilomètres de là, à Singapour, un même voyageur s’apprête à embarquer dans un métro automatisé. L’application de transport lui a suggéré l’itinéraire optimal selon l’affluence attendue et les conditions météo. Il ne sait pas vraiment qu’un algorithme a recalculé les horaires du train cette nuit. Mais il sait qu’il arrivera à l’heure.
Entre Paris et Singapour, tout semble opposer les modèles de mobilité. L’une doit composer avec un héritage urbain séculaire, un réseau saturé et des arbitrages politiques complexes. L’autre anticipe, régule et ajuste en temps réel dans une logique de planification centralisée. Mais les deux villes partagent un même impératif : comprendre les flux pour mieux les piloter.
Dans cette équation, l’intelligence artificielle devient une alliée stratégique. En aidant les collectivités à lire les dynamiques de déplacement, à anticiper les congestions ou à ajuster les services, elle redéfinit les marges d’action possibles.
Alors, que peuvent ces deux villes apprendre l’une de l’autre ? Quelles sont leurs limites respectives ? Et comment des outils IA peuvent-ils s’adapter à des contextes aussi différents ?
Paris : un réseau hérité sous tension

À Paris, la mobilité est le produit d’un héritage urbain dense, complexe, et largement figé. La capitale française, au sens large de son agglomération, concentre près de 12 millions d’habitants, répartis entre Paris intra-muros et trois couronnes périurbaines aux réalités contrastées. Le réseau de transport s’est développé par strates, avec une logique de centralité qui continue d’organiser la majorité des flux vers le cœur de la ville.
Le métro parisien, inauguré en 1900, compte aujourd’hui 16 lignes et plus de 300 stations, avec une fréquentation quotidienne moyenne de près de 5 millions de voyageurs. Certaines lignes, comme la 13, la 4 ou la 12, sont saturées en heure de pointe depuis des années. Le RER, destiné à desservir les zones plus éloignées, complète ce dispositif avec 5 lignes régionales (A à E) reliant la banlieue au centre mais lui aussi souffre de vieillissement, de retards fréquents et d’une sous-capacité structurelle. Les bus représentent le réseau de surface le plus vaste, avec plus de 1 000 lignes en Île-de-France, mais ils sont directement affectés par la congestion routière. Leur vitesse moyenne a chuté à environ 9 km/h dans Paris intra-muros. Côté mobilité douce, Paris a fortement développé les infrastructures cyclables depuis 2020, avec un réseau en extension (Plan Vélo) et un parc de vélos en libre-service (Vélib’, plus de 20 000 vélos disponibles).
Les trottinettes électriques, qui ont connu une forte expansion entre 2018 et 2022, ont été retirées du domaine public en septembre 2023, suite à une consultation citoyenne. Elles subsistent aujourd’hui uniquement en usage privé, mais témoignent du besoin croissant de souplesse dans les trajets de courte distance et dans l’intermodalité.
Enfin, le Grand Paris Express, immense chantier de 200 km de métro automatique, incarne la volonté de sortir du modèle en étoile. Mais sa livraison progressive (jusqu’à 2030) laisse intacte, à court terme, la nécessité d’optimiser ce qui existe déjà. Depuis plusieurs années, la ville s’engage dans une réduction massive de la place de la voiture individuelle. Cette stratégie repose sur plusieurs axes structurants :
- La création de Zones à Faibles Émissions (ZFE), qui restreignent l’accès aux véhicules les plus polluants dans Paris et certaines communes de la métropole ;
- La suppression de voies de circulation automobile, réattribuées à des pistes cyclables, à des espaces piétons ou à des voies de bus ;
- La piétonnisation croissante de certains quartiers (Marais, rive droite de la Seine, etc.), qui transforme l’usage de la ville au quotidien.
Ces choix s’accompagnent d’une volonté affirmée de développer les mobilités dites “actives” : marche, vélo, usage partagé. Leur progression est indéniable. Les pistes cyclables ont gagné en linéarité, en continuité, en visibilité. Les usages évoluent, les trajets courts se décarbonent. Mais ce changement de paradigme se heurte à une logistique urbaine complexe (livraisons, flux commerciaux, voirie partagée) et à des arbitrages politiques permanents : entre riverains, commerçants, automobilistes, usagers des transports en commun.
Si la gouvernance des transports reste morcelée, Paris n’est pas étrangère à la dynamique “smart city”. La Ville et la Région Île-de-France s’engagent depuis plusieurs années dans des projets mêlant données, modélisation et intelligence artificielle.
Des acteurs comme Île-de-France Mobilités, la RATP ou la SNCF développent des outils d’analyse prédictive, de gestion en temps réel des flux, ou encore de mobilité à la demande, en lien avec des startups comme Entropy. Paris a également massivement ouvert ses données publiques, posant les bases d’une gouvernance augmentée par la donnée, même si cette transformation reste progressive, sectorielle et portée par différents niveaux de décision.
Dans cette tension permanente entre héritage et transition, Paris ne peut pas s’en remettre à l’infrastructure seule. Elle doit inventer une nouvelle forme de pilotage. Et ce que Paris cherche à faire aujourd’hui, c’est transformer un réseau hérité en un système intelligent. Non pas en ajoutant toujours plus, mais en comprenant mieux ce qui existe : où sont les tensions réelles, quels sont les besoins invisibles, comment lisser les flux dans le temps et l’espace. Cette logique suppose un changement d’outils, de posture et de temporalité. Il ne s’agit plus seulement de transporter plus vite, mais de décider plus juste.
Singapour, la ville qui a industrialisé la régulation

À l’opposé du tissu parisien, Singapour incarne un modèle de mobilité planifiée, régulée et automatisée. Sur ce territoire de 728 km², où vivent environ 5,6 millions d’habitants, l’urbanisme et les transports ont été pensés conjointement, avec un objectif central : éviter la saturation avant qu’elle n’apparaisse.
Contrairement à Paris, Singapour ne cherche pas à composer avec un réseau hérité. Elle conçoit sa ville pour la mobilité, en répartissant les fonctions urbaines (résidentiel, emploi, services) de manière équilibrée, à l’échelle de quartiers autonomes et bien interconnectés. Cette stratégie de long terme repose sur trois piliers structurants : anticipation, régulation, automatisation.
Anticipation : planification par la donnée
Singapour est l’un des premiers pays au monde à avoir intégré l’exploitation de la donnée dans la gouvernance urbaine. Dès 2014, la Smart Nation Initiative a placé la mobilité au cœur d’un programme public d’innovation. La Land Transport Authority (LTA) collecte, croise et utilise massivement les données issues du réseau, de la billettique, des GPS, des capteurs, pour planifier les investissements, ajuster l’offre et identifier les besoins émergents. Les lignes de métro (MRT) sont conçues avec une vision à 10 ou 20 ans, intégrant dès la phase de planification des prévisions de trafic, de densité de population et de polarité des flux. Le résultat : un réseau souple, évolutif, et connecté aux usages réels.
Régulation : limiter la voiture avant qu’elle ne domine
Singapour applique une régulation de la mobilité privée sans équivalent. Depuis 1998, le système de péage urbain électronique ERP (Electronic Road Pricing) ajuste en temps réel le tarif des axes les plus fréquentés, selon l’heure, le lieu et la congestion. Une nouvelle génération de ce système (ERP 2.0) est en cours de déploiement, avec des unités embarquées dans les véhicules, permettant une gestion encore plus fine du trafic.
En parallèle, l’acquisition d’un véhicule est soumise à un certificat d’immatriculation (COE), délivré en nombre limité et à prix variable. Ce système permet de maîtriser le nombre total de véhicules en circulation, indépendamment de l’appétence individuelle pour la voiture.
Comprendre et anticiper la demande : la donnée au centre du pilotage
La gestion moderne de la mobilité repose sur une connaissance fine des comportements de déplacement. C’est ici que l’intelligence artificielle, associée à des données de mobilité, devient un outil central. Elle permet de cartographier les flux, de comprendre les motifs des déplacements, et de prévoir la demande à court terme. Ces capacités sont indispensables pour piloter les systèmes de transport de manière dynamique.
Automatisation : fluidité algorithmique
La quasi-totalité du réseau MRT est automatisée, ce qui permet de faire varier les fréquences en fonction de la demande, sans dépendre des contraintes humaines. Des bus autonomes sont testés en conditions réelles, et plusieurs services de transport à la demande s’appuient déjà sur des algorithmes prédictifs pour proposer des trajets optimisés.
Même les trajets privés sont encadrés par la donnée. L’application Beeline, développée avec la LTA, propose des itinéraires de bus semi-privés en s’appuyant sur les flux historiques et les besoins remontés par les usagers.
Dans ce système, la donnée n’est pas un complément, mais un pilier. L’enjeu n’est pas de rattraper le déséquilibre, mais de l’éviter. Chaque trajet est anticipé, chaque congestion éventuelle modélisée, chaque décision prise avec une vision d’ensemble.
Singapour ne cherche pas à faire plus de place aux mobilités alternatives : elle dessine la ville autour d’elles.
Mais cette approche a aussi ses conditions : une gouvernance unifiée, une capacité d’investissement forte, et une population en grande partie habituée à un haut niveau de contrôle technologique.
Deux villes, une même exigence : prédire pour mieux agir
Entre Paris et Singapour, les contrastes sont profonds : gouvernance, urbanisme, culture de la mobilité, temporalité des projets. Pourtant, les deux villes convergent sur un point : la nécessité d’anticiper pour ne plus subir. Car quelle que soit l’infrastructure ou la stratégie, l’imprévu coûte cher. Congestion, reports modaux mal anticipés, affluence mal gérée, ressources mal allouées, les conséquences se mesurent en heures perdues, en insatisfaction usagers, en émissions inutiles.
La donnée devient alors un actif stratégique. À Paris, elle permet de faire émerger une lecture fine des flux dans un système hérité. À Singapour, elle est intégrée dès l’amont de la décision, comme une composante de la planification. Dans les deux cas, elle constitue le socle d’une mobilité plus fluide, plus efficace, plus résiliente.
Mais l’analyse rétrospective ne suffit plus. Ce qui se joue aujourd’hui, c’est le passage à une logique prédictive, où l’on ne se contente pas de savoir ce qui s’est passé, mais ce qui va se passer et comment s’y préparer. Cela implique une montée en puissance de l’intelligence artificielle, non pas comme gadget, mais comme outil de pilotage.
De l’observation à la décision
Paris commence à intégrer ces outils à travers des expérimentations locales, des partenariats publics-privés, ou des services à la demande. Singapour les déploie à grande échelle, dans une logique de régulation automatisée. Mais les enjeux sont similaires :
- Comment identifier les points de congestion avant qu’ils n’apparaissent ?
- Comment ajuster les fréquences de métro, de bus ou de TAD en fonction des conditions réelles ?
- Comment réagir en temps réel à un pic météo, à une perturbation, à un événement majeur ? Ce sont des questions opérationnelles, mais aussi stratégiques. Elles supposent de faire confiance à des systèmes capables non seulement d’alerter, mais aussi de recommander.
Dans ce paysage mouvant, l’IA devient un levier d’équité autant que d’efficacité. Elle permet de mieux répartir les ressources, de fluidifier sans exclure, d’adapter les réseaux aux usages réels plutôt qu’aux moyennes historiques. Paris et Singapour n’ont pas les mêmes contraintes, ni les mêmes outils. Mais elles partagent un besoin commun : transformer la complexité en lisibilité, et la lisibilité en décision.
Cas d’usage : les solutions Entropy dans ces deux contextes
Dans un paysage urbain saturé comme celui de Paris, ou dans un système ultra-régulé comme celui de Singapour, la clé est la même : mieux comprendre pour mieux décider. C’est précisément dans cette logique qu’interviennent les solutions développées par Entropy. Reposant sur des modèles d’intelligence artificielle prédictive, ces outils ont pour objectif de rendre visibles les dynamiques de mobilité, de prévoir les flux à court et moyen terme, et d’aider à piloter les services de manière plus fine, plus ciblée, plus réactive.
Fluidity : cartographier les flux invisibles Fluidity permet de visualiser et d’analyser les trajectoires de déplacement selon différents paramètres : motifs, profils, modes de transport, temporalités, émissions. En Île-de-France, il est déjà utilisé pour identifier les zones de saturation, comprendre les effets de report modal, ou orienter la priorisation des aménagements cyclables ou piétons.
À Singapour, un tel outil pourrait permettre de suivre plus finement les flux inter-quartiers, repérer les corridors à forte pression malgré une offre de transport dense, ou mesurer l’impact localisé de certaines politiques tarifaires.
Node : reconstituer les itinéraires pour ajuster les infrastructures Node s’appuie sur des données GPS pour reconstituer les itinéraires réellement empruntés par les véhicules, qu’ils soient privés, professionnels ou logistiques. Cela permet d’identifier les routes sur-sollicitées, les contournements récurrents, ou les points de congestion structurels.
À Paris, Node est utilisé pour accompagner des projets de requalification urbaine, d’implantation de parkings ou de régulation d’accès. À Singapour, il pourrait affiner les décisions de régulation déjà en place : dépriorisation de certains axes, réaménagement de nœuds de circulation, ou ajustement des zones de livraison.
Azoth : anticiper les flux pour piloter en temps réel Cœur prédictif du système, Azoth modélise les flux à venir sur des horizons de quelques heures à plusieurs jours. Il prend en compte les données de géolocalisation, l’historique des trajets, la météo, les événements, et les comportements passés pour produire des prévisions de fréquentation localisées.
En Île-de-France, Azoth est utilisé pour ajuster les flottes de transport à la demande, prévenir les saturations ponctuelles, ou optimiser les horaires en période de tension.
Dans un contexte comme Singapour, où les réseaux sont déjà largement automatisés, Azoth pourrait alimenter directement les systèmes de régulation : modification dynamique des fréquences du MRT, anticipation des flux piétons autour d’événements, ou réallocation de services logistiques en fonction des prévisions.
L’ambition d’Entropy n’est pas d’imposer une solution universelle, mais de proposer des outils adaptables, capables de fonctionner à la fois dans un environnement contraint comme Paris, et dans un système plus fluide mais exigeant comme Singapour.
Conclusion
Entre les ruelles historiques de Paris et les quartiers planifiés de Singapour, deux visions de la mobilité s’affrontent sans vraiment se contredire. L’une, contrainte par l’héritage et l’hétérogénéité de ses réseaux, cherche à rendre intelligible un système déjà saturé. L’autre, construite sur la prévoyance et la régulation, affine un modèle pensé pour éviter les déséquilibres. Mais derrière ces différences se cache une même transformation en cours : celle du passage d’un pilotage réactif à une gestion prédictive.
L’intelligence artificielle, loin d’être une fin en soi, devient un levier décisif pour mieux comprendre, anticiper et orchestrer la mobilité urbaine. En s’appuyant sur la donnée, Paris et Singapour s’engagent dans une révolution silencieuse : celle d’un transport pensé comme un écosystème vivant, ajustable et réactif.
Le défi n’est plus seulement de déplacer plus de monde, plus vite. Il est de le faire mieux, avec justesse, équité, et résilience. Et sur ce chemin, chaque ville, quels que soient son histoire ou son modèle, a encore beaucoup à apprendre de l’autre, de ses usagers, et de ses propres données.