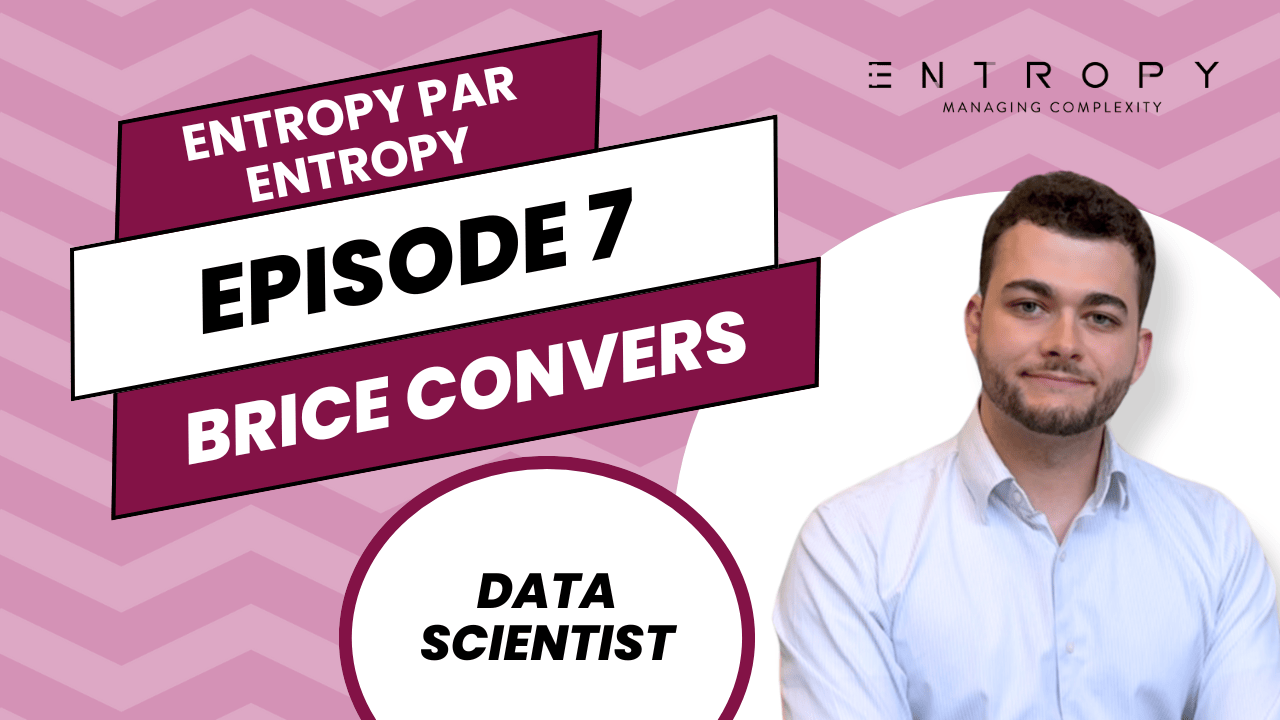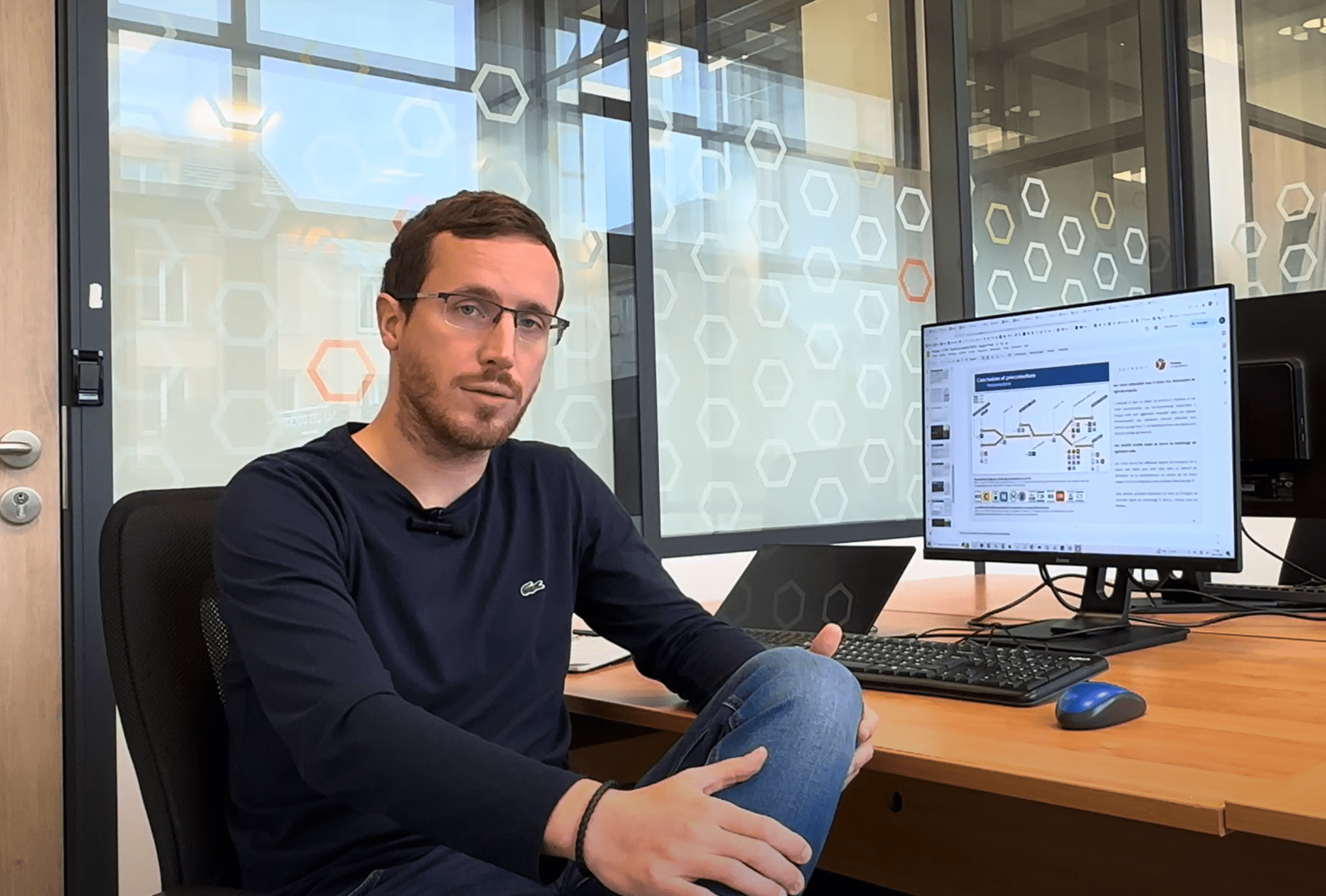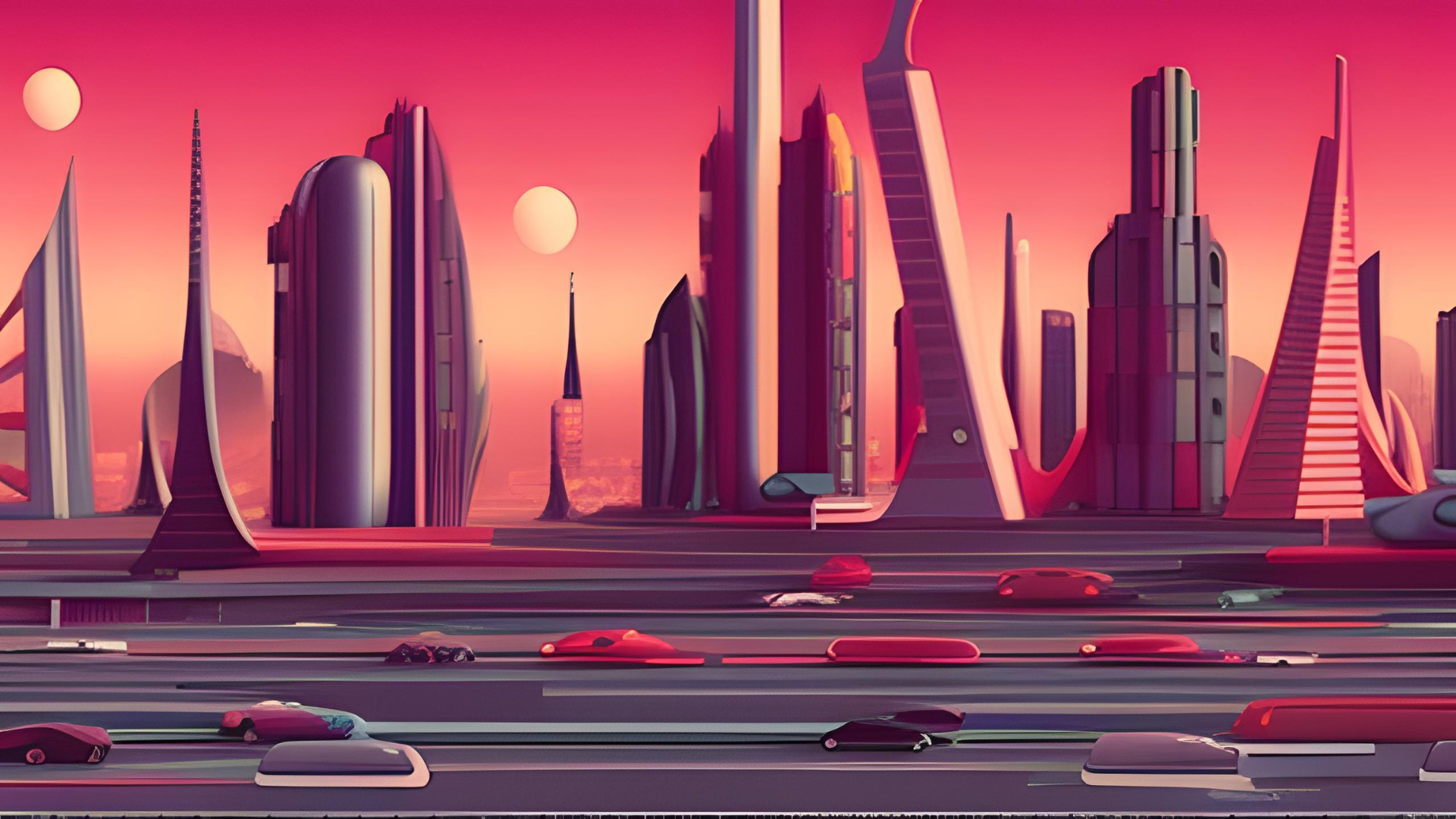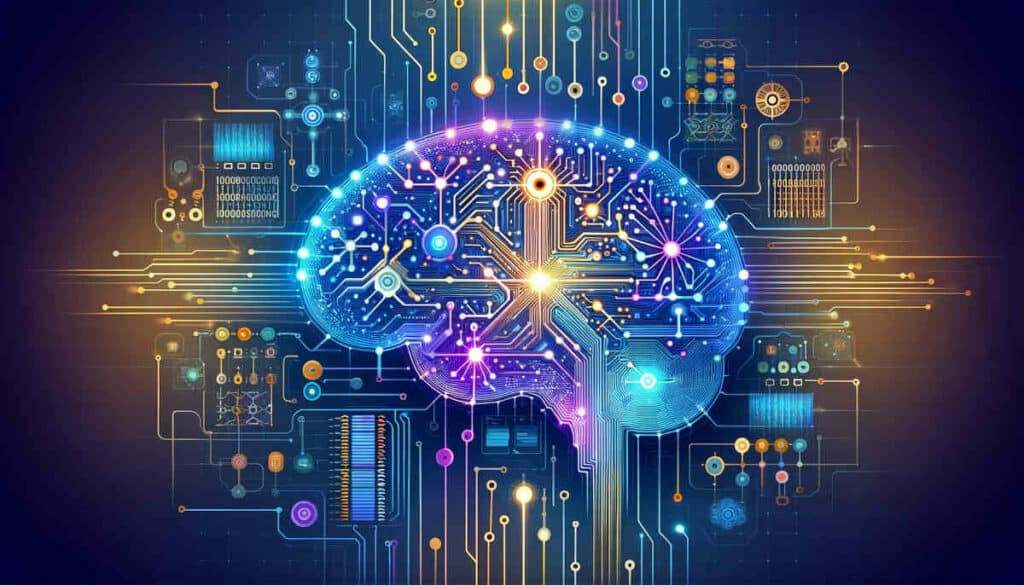 illustration Pixabay
illustration Pixabay
Il est 8h, quelque part en ville. Vous avez prévu de prendre un vélo en libre-service pour vous rendre au travail. En arrivant à la station, elle est vide mais à quelques rues de là, une autre station déborde de vélos que personne ne récupère. Le soir, en sortant du bureau, vous essayez de dîner sans réservation dans un restaurant habituellement tranquille. Il est complet. À cinq minutes de marche, un autre reste à moitié vide toute la soirée.
Ces déséquilibres n’ont rien d’exceptionnel. Ils ne sont pas dus à un incident technique, ni à une mauvaise organisation humaine. Ils sont simplement le reflet d’un manque d’anticipation. Trop souvent, les services, qu’il s’agisse de mobilité, de restauration ou d’accueil du public réagissent après que les problèmes se produisent. Résultat : des ressources mal réparties, des usagers insatisfaits, des opportunités perdues et une empreinte carbone inutilement alourdie.
Et si la ville pouvait prévoir ? Savoir à l’avance où, quand, et combien de personnes vont arriver dans un lieu donné, pour un service donné ? Répartir les véhicules, adapter les effectifs, dimensionner les stocks, non pas au doigt mouillé, mais à partir d’une vision claire et continue des flux à venir ?
C’est exactement ce que permet aujourd’hui l’intelligence artificielle prédictive : transformer des données en prévisions concrètes et ces prévisions en décisions utiles avant que les déséquilibres ne deviennent visibles.
C’est à partir de ce besoin très opérationnel que se développe une nouvelle génération d’outils d’aide à la décision, pensés non seulement pour les opérateurs de transport, mais aussi pour les restaurateurs, les gestionnaires d’espaces publics, les collectivités et tous ceux qui doivent anticiper l’affluence pour mieux organiser le service.
A prédictive et IA décisionnelle : comprendre le duo gagnant
Pour répondre aux défis de l’anticipation, deux branches complémentaires de l’intelligence artificielle jouent un rôle clé : l’IA prédictive et l’IA décisionnelle.
L’IA prédictive : prévoir les comportements
L’IA prédictive s’appuie sur des volumes massifs de données passées et présentes pour estimer des comportements futurs. Grâce à des algorithmes d’apprentissage automatique, elle identifie des motifs récurrents dans les usages :
- Fréquentation selon l’heure ou la météo,
- Influence des jours fériés,
- Impact d’événements locaux,
- Ou encore variations selon les saisons.
Elle transforme ces données brutes en prévisions fines, localisées dans l’espace et dans le temps. On ne parle pas seulement d’un “pic” à venir, mais de combien, où et quand.
L’IA décisionnelle : passer à l’action
L’IA décisionnelle prend le relais. Son rôle n’est plus d’observer ou de prévoir, mais de recommander des actions concrètes :
- Faut-il déployer plus de personnel ?
- Ajouter des véhicules à un endroit précis ?
- Adapter les horaires ou les stocks ?
- Ouvrir ou fermer un accès temporairement ?
Elle transforme les prévisions en leviers d’action opérationnels, pour optimiser l’organisation des services en amont, avant que les déséquilibres ne deviennent visibles sur le terrain.
Comment ça fonctionne : des données à l’action
Prévoir la demande et adapter les services en temps réel repose sur un enchaînement de trois étapes clés : collecter, modéliser, décider.
Collecter les données : capter les signaux utiles
La qualité des prévisions dépend de la diversité et de la pertinence des données utilisées. Ces données proviennent de sources multiples, internes comme externes :
- Données historiques : réservations passées, fréquentation horaire, ventes, validateurs de tickets
- Données en temps réel : capteurs de présence, météo instantanée, flux sur les réseaux sociaux, données événementielles locales
- Systèmes internes : CRM, terminaux de paiement, applications mobiles, outils de gestion
- Données publiques : open data, agendas municipaux, horaires d’événements, trafic
Toutes ces informations, croisées intelligemment, permettent de dresser une image dynamique et contextuelle de la demande à venir.
Modéliser : transformer les données en prévisions exploitables
Une fois les données collectées, elles sont traitées par des modèles statistiques et des algorithmes d’apprentissage automatique :
- Machine learning, pour apprendre des comportements passés
- Deep learning, pour repérer des corrélations complexes
- Statistiques avancées, pour modéliser les variations saisonnières, météorologiques ou événementielles
L’objectif n’est pas seulement de prédire combien de personnes viendront, mais aussi quand elles arriveront, où, et avec quel niveau de certitude. Ces prévisions peuvent être ajustées en permanence à mesure que de nouvelles données arrivent.
Décider : activer les bonnes mesures au bon moment
Une fois la prévision établie, l’IA décisionnelle entre en jeu. Elle propose, sous forme d’indicateurs clairs ou de recommandations concrètes, des actions à mener :
- Réaffecter du personnel vers un point de tension identifié
- Modifier les horaires d’ouverture ou de service
- Ajuster les volumes de production, d’approvisionnement ou de stock
- Déclencher des mesures préventives (limitation d’accès, communication en amont, alternative proposée)
C’est ce passage de la donnée brute à la décision actionnable qui permet de faire la différence sur le terrain.
Pourquoi c’est devenu indispensable aujourd’hui ?
Les outils d’anticipation ne sont plus réservés aux grands groupes ou aux situations exceptionnelles. Ils répondent aujourd’hui à une pression constante sur les services urbains, publics ou privés. Plusieurs facteurs rendent l’IA prédictive et décisionnelle essentielles au quotidien.
Des comportements de plus en plus imprévisibles
Les habitudes d’usage sont devenues instables :
- Le télétravail modifie les flux quotidiens,
- La météo influence les sorties au dernier moment,
- Les comportements post-COVID ont brouillé les modèles classiques de fréquentation.
Dans ce contexte, s’appuyer sur les seuls historiques ou sur l’intuition ne suffit plus. Il faut des outils capables de s’adapter en permanence à des situations changeantes.
Des services sous tension permanente
Qu’il s’agisse de transport, de restauration ou d’accueil du public, les marges de manœuvre sont faibles :
- Personnel limité,
- Espaces restreints,
- Budgets contraints.
Chaque erreur d’anticipation a un coût immédiat : sur-effectif inutile ou sous-effectif critique, gaspillage ou pénurie, attentes frustrantes ou lieux désertés.
Des usagers moins tolérants à l’imprévu
Les attentes ont changé :
- Moins de patience face à l’attente ou aux files d’attente,
- Moins de tolérance pour les fermetures imprévues ou les services non disponibles,
- Plus de recherche de fluidité, de confort, et de personnalisation.
Répondre à ces attentes suppose d’anticiper plutôt que de réagir.
Des enjeux environnementaux et économiques majeurs
Optimiser les flux, c’est aussi éviter des trajets inutiles, réduire les surconsommations, limiter les pics de ressources :
- Moins de camions en rotation pour rééquilibrer des vélos,
- Moins de repas gaspillés,
- Moins de personnel mobilisé pour rien.
En d’autres termes, mieux anticiper, c’est consommer moins pour rendre un meilleur service.
Des cas d’usage concrets : de la rue au comptoir
L’intelligence artificielle prédictive n’est pas un concept abstrait. Elle est déjà utilisée dans des contextes très variés pour améliorer concrètement l’organisation des services. Voici trois domaines où ses effets sont particulièrement visibles.
Mobilité à la demande : anticiper les flux, équilibrer les réseaux
Dans les services de mobilité partagée – vélos, scooters, navettes –, l’un des principaux défis est de réduire les déséquilibres entre les stations. Trop souvent, certaines sont pleines et d’autres vides, rendant l’expérience frustrante pour les usagers.
Avec l’IA prédictive :
- On peut prévoir un afflux vers une zone de bureaux le matin et organiser le repositionnement des véhicules en fin de journée,
- Détecter une hausse ponctuelle liée à un concert, un match ou un salon professionnel, et renforcer l’offre temporairement.
Exemple : une régie de transport ajuste la flotte de navettes électriques en fonction des pics attendus vers une zone commerciale les week-ends.
Restaurants, cafés, cantines : adapter l’offre à la demande réelle
Dans la restauration, chaque client non anticipé peut générer une rupture de service ; chaque client non venu peut représenter une perte sèche. L’IA permet de mieux ajuster les ressources humaines et matérielles.
Grâce à des prévisions intégrant météo, événements et historiques :
- Les effectifs en salle et en cuisine peuvent être adaptés en amont,
- Les stocks peuvent être calibrés pour éviter le surstockage comme les ruptures,
- Les menus ou les horaires peuvent être ajustés selon la fréquentation prévue.
Cas d’usage : une cantine scolaire prépare le bon nombre de repas en tenant compte d’un taux d’absentéisme plus élevé les jours de pluie ou de sortie scolaire.
Commerces et lieux publics : mieux gérer les flux et les équipes
Dans les espaces publics ou commerciaux, la capacité à anticiper les flux de fréquentation permet de prévenir les situations de saturation et de mieux planifier les services associés.
Avec une vision prédictive :
- Les équipes de nettoyage ou de sécurité peuvent être déployées là où l’affluence est prévue,
- Les accès peuvent être régulés en amont,
- Les messages aux usagers peuvent être adaptés pour inciter à répartir la fréquentation.
Exemple : une mairie anticipe un afflux important sur une place publique à l’heure de sortie des bureaux, en lien avec la météo et un événement local. Elle redéploie des agents pour fluidifier les circulations et renforcer la présence.
Entropy : anticiper les flux pour mieux organiser les services
Dans cet écosystème où chaque minute compte et où chaque déséquilibre peut avoir un impact opérationnel fort, Entropy propose une réponse concrète à travers sa suite d’outils d’intelligence artificielle, notamment Azoth, son moteur prédictif.
Pensé pour les acteurs de la mobilité, de la restauration, du commerce ou encore des collectivités, Azoth transforme les données disponibles (même partielles) en prévisions de fréquentation localisées, compréhensibles et activables. Sa force réside dans sa capacité à produire des prédictions fiables à court et moyen terme, tout en restant lisible et opérationnel pour les décideurs de terrain.
Voici quelques applications concrètes : – Mobilité : Azoth Mobilité permet d’anticiper l’occupation des stations de vélos ou de scooters partagés, de moduler la flotte en fonction des flux attendus, et de fluidifier les trajets dans les zones à forte tension. – Restauration : Azoth Prévision aide les restaurateurs à prévoir les affluences selon l’heure, la météo ou les événements locaux, pour adapter les équipes, les approvisionnements ou même la carte. – Espaces publics : dans les lieux sensibles (gares, places, musées, marchés), il identifie les pics de fréquentation à venir et permet d’organiser les moyens humains et logistiques avant que les problèmes ne surviennent.
Conclusion : prévoir pour mieux servir
Dans une ville toujours plus rapide, plus dense, plus exigeante, l’anticipation devient une compétence essentielle. Qu’il s’agisse de vélos partagés, de repas à servir, d’équipes à mobiliser ou d’espaces à réguler, la capacité à prévoir les flux et adapter les ressources en amont est devenue un levier décisif de qualité de service, d’efficacité économique et de sobriété environnementale.
Grâce à l’intelligence artificielle prédictive et décisionnelle, il ne s’agit plus de subir les imprévus, mais de les prévenir, les contourner, ou les transformer en opportunité. Avec des outils comme ceux d’Entropy, cette vision n’est plus théorique : elle est opérationnelle, concrète, et à portée de main.
La ville intelligente n’est pas seulement celle qui capte des données. C’est celle qui les comprend, les anticipe, et agit juste à temps.